Maitres du monde, le nouveau roman de Victor Cohen Hadria, nous entraîne dans une enquête policière et identitaire sur les rives de l’Adriatique … C’est dans le dédale des rues en pente de Trieste que le héros amnésique va naviguer dans le labyrinthe de son cerveau pour retrouver son identité. La nostalgie est partout dans ce Trieste qui vibre de sa gloire passée entre la splendeur extravagante de ses propriétés, le foisonnement de ses cafés, la poésie de ses docks où errent des personnages désuets, somptueux et truculents. Entretien.
Lecthot : Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire ce roman ?
Victor Cohen Hadria : On vit dans un monde étrange, où l’on ne peut se rattraper à rien. Alors qu’auparavant, quand je suis né (c’est-à-dire il y a cent ans) les gens avaient des certitudes. Des certitudes qui n’existent plus. De nos jours, on ne peut être certain de rien, alors on se rattrape aux branches et on est tout le temps en train de se dire « pourquoi », « comment », comme si nous étions à l’ère néolithique ! Nous pensons qu’il y a des puissances transcendantales qui guident nos pas. La théorie du complot en est le meilleur exemple. Qu’est-ce que l’Iliade, sinon un complot monté par les dieux pour les hommes qui s’en démerdent comme ils peuvent ? Voilà ce que l’on réinvente encore aujourd’hui.
On crée des théories pour chercher Dieu. Un dieu méchant qui utilise les humains pour qu’ils s’entretuent, convaincus que nous sommes néfastes. Alors j’ai tenté une réflexion autour de cela, autour de cette espèce de fin du monde. J’ai cherché l’endroit où elle serait la plus agréable à regarder, et je me suis dit que Trieste serait un bel endroit pour ça. Un endroit qui est déjà mort depuis très longtemps et devenu une espèce de fossile. C’était la capitale maritime d’un empire qui n’existe plus, disparu au XXe siècle avec l’empire austro-hongrois. Une ville sans sens. Un lieu particulier où il fait bon contempler la fin du monde. Puis je me suis demandé ce qu’il fallait faire et qui nous étions. Je me suis rendu compte qu’on était amnésiques. Nous sommes menés par des évènements qui nous échappent et par notre inconscient. Alors on oublie, car si on n’oubliait pas, on mourrait. Donc j’ai raconté l’histoire d’un type qui oublie tout. Et lorsqu’il se réveille, il se rend compte qu’il a eu une vie auparavant. Une vie dans laquelle il a été manipulé. J’ai essayé de faire le portrait de la société dans laquelle on vit, partant de la fin de l’an 1999.
L : Quel sentiment aimeriez-vous susciter chez le lecteur ?
V.C.H. : Avec la méchante manipulation de l’auteur (car l’auteur est un manipulateur), je voulais mettre en avant des thèmes précis : la psychanalyse, le pouvoir, le jeu, l’inconscient et l’écriture (c’est à dire l’expression). Je voulais faire cohabiter ces motifs afin que le type qui pense que la vie est un jeu se dise qu’elle n’est peut-être pas si ludique, et que celui qui pense que la vie n’est que le fondement d’un système inconscient trouve des moyens pour la mener quand même. Par ailleurs, j’ai deux ou trois personnes autour de moi dont je sais qu’elles vont être furieuses de ce que j’ai écrit, et ça me fait très plaisir !
L : Pourquoi seront-elles furieuses ?
V.C.H. : Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans une église en disant « Dieu, t’es un con ! ». Quoique ce n’est pas si grave. L’Eglise et Dieu s’en foutent probablement.
Le « Code Hays » aux Etats-Unis (appliqué de 1934 à 1966) servait à garantir les bonnes mœurs des films américains. Ne pas montrer d’actes sexuels, ne pas filmer de baiser durant plus de 30 secondes, etc. Les cinéastes américains se sont alors amusés à détourner cette censure. Dans Les Enchaînés d’Hitchcock, Ingrid Bergman et Cary Grant sont filmés en train de s’embrasser par séquences de 29 secondes.
La création, c’est aller contre la doxa. Quitte à ne pas être aimé ou à se planter la gueule. Sinon, on est un clerc qui ne fait que recopier ce que font les autres. De Rabelais jusqu’à qui vous voulez (je ne vais pas citer des concurrents) notre métier est de cracher dans la soupe. Voilà pourquoi j’aime faire enrager un certain nombre de gens.
L : Dans Maîtres du monde, plusieurs figures apparaissent : un mathématicien, un physicien, un informaticien, un historien, un musicien, un poète, un philosophe… S’ils sont un peu à votre image, que n’êtes-vous pas ?
V.C.H. : Ils ne sont pas moi. Parce que moi, au cas où vous ne le savez pas je suis Flaubert. Ce qui peut être moi, ce n’est pas ce qu’ils sont, c’est ce qu’ils font. On ne peut pas demander à quelqu’un « qui êtes-vous ? », alors on demande « Que faîtes-vous ? » Mais entre ce que l’on fait et ce qu’on est, il y a une grande différence.
L : Le livre présente une construction complexe. Comment l’avez-vous conçue ? Avez-vous fait des plans sur papier, sur ordinateur ou aucun plan ?
V.C.H. : J’essaie de rendre le réel présent et le présent n’est pas linéaire. C’est un tissu. La journée dure 24 heures mais pendant ces 24 heures, d’autres temporalités s’immiscent. Mon livre m’a pris 5 ans. Mon œuvre, 40 ans. Certes, à chaque fois je suis dans une linéarité, mais en réalité c’est plutôt un tissu au sein duquel tout se conjugue.
La littérature est le seul endroit où l’on n’est contraint par rien du tout. Je tiens à ma liberté, qui n’est pas forcément de dire ce que j’ai envie de dire (parce que je ne crois pas que la littérature dise des choses) mais montrer ce que j’ai envie de montrer avec les moyens que j’ai envie d’utiliser. Il faut être déjanté, sinon à quoi ça sert ? Si je vous raconte qu’à mon âge je vieillis, que je suis triste parce que j’étais beaucoup mieux quand j’avais 30 ans, qui sera intéressé ?
Cette liberté est une espèce de joie, une jubilation d’écrire, de s’abandonner, et comme je n’ai pas un caractère craintif, je suis ce mouvement. Car que peut-il m’arriver après tout ? j’ai encore 70 ans à vivre… Pourquoi vous riez ? Vous n’y croyez pas ?
L : Qu’est-ce que le roman dit de vous ?
V.C.H. : Tout a toujours une part autobiographique. Je suis né à Tunis, comme mon personnage. Mon personnage précédent était né à Caen, je n’y suis pas né. Et tout le monde m’a dit que j’étais né à Caen, et vous verrez que l’on me dira bientôt que je ne suis pas né à Tunis ! C’est intéressant.
Mon roman parle de Trieste, je n’y ai jamais mis les pieds. C’est autobiographique sans l’être…C’est autobiographique malgré moi. Mais un jour j’écrirai une autobiographie, quand je serai riche et célèbre et que ça intéressera quelqu’un.
L : La Tunisie de votre roman est-elle celle de votre enfance ?
V.C.H. : La Tunisie est quasiment le seul pays à avoir été opposé à Rome. On aurait pu être carthaginois au lieu d’être romains. Ce sont les vaincus. Lorsque le christianisme est né, la doctrine de l’église s’est forgée à Carthage. Puis c’est devenu un pays arabe, musulman, qui a effacé tout cela. Il y a désormais des ruines partout. Le passé resurgit. Quand il pleut, on voit les pièces romaines qui sortent du sol puisqu’il n’y a pas de trottoir à Carthage.
C’est par ailleurs un pays qui a été peuplé par les vandales. Ça me fait très plaisir d’être né aux pays des vandales. Quand mes parents disaient que j’étais un vandale j’avais une justification.
Le livre
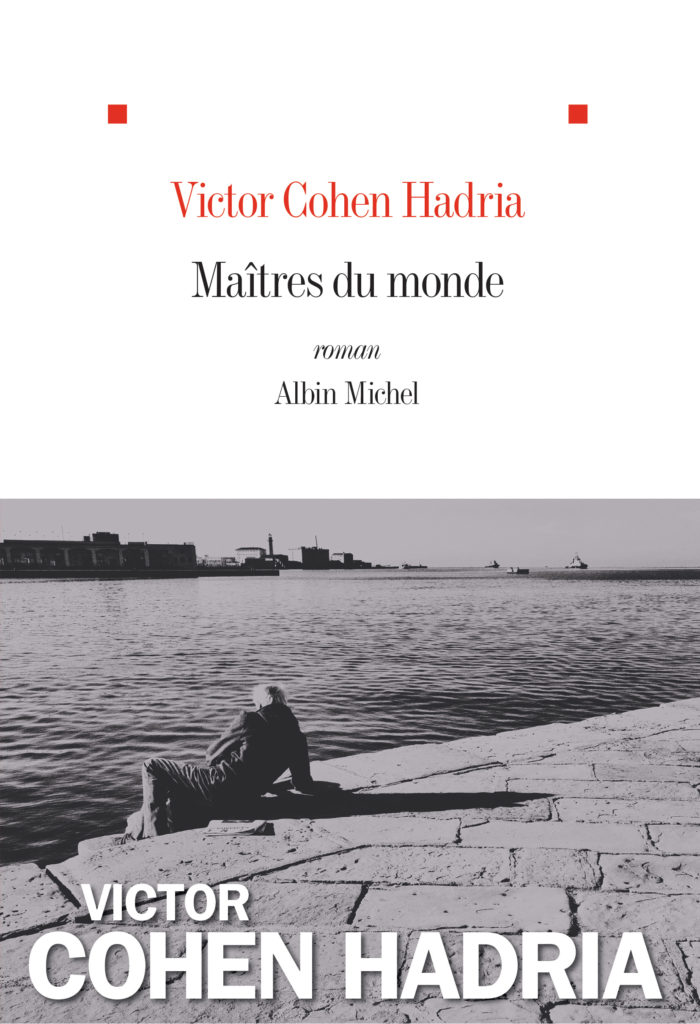
 Lecthot
Lecthot 




